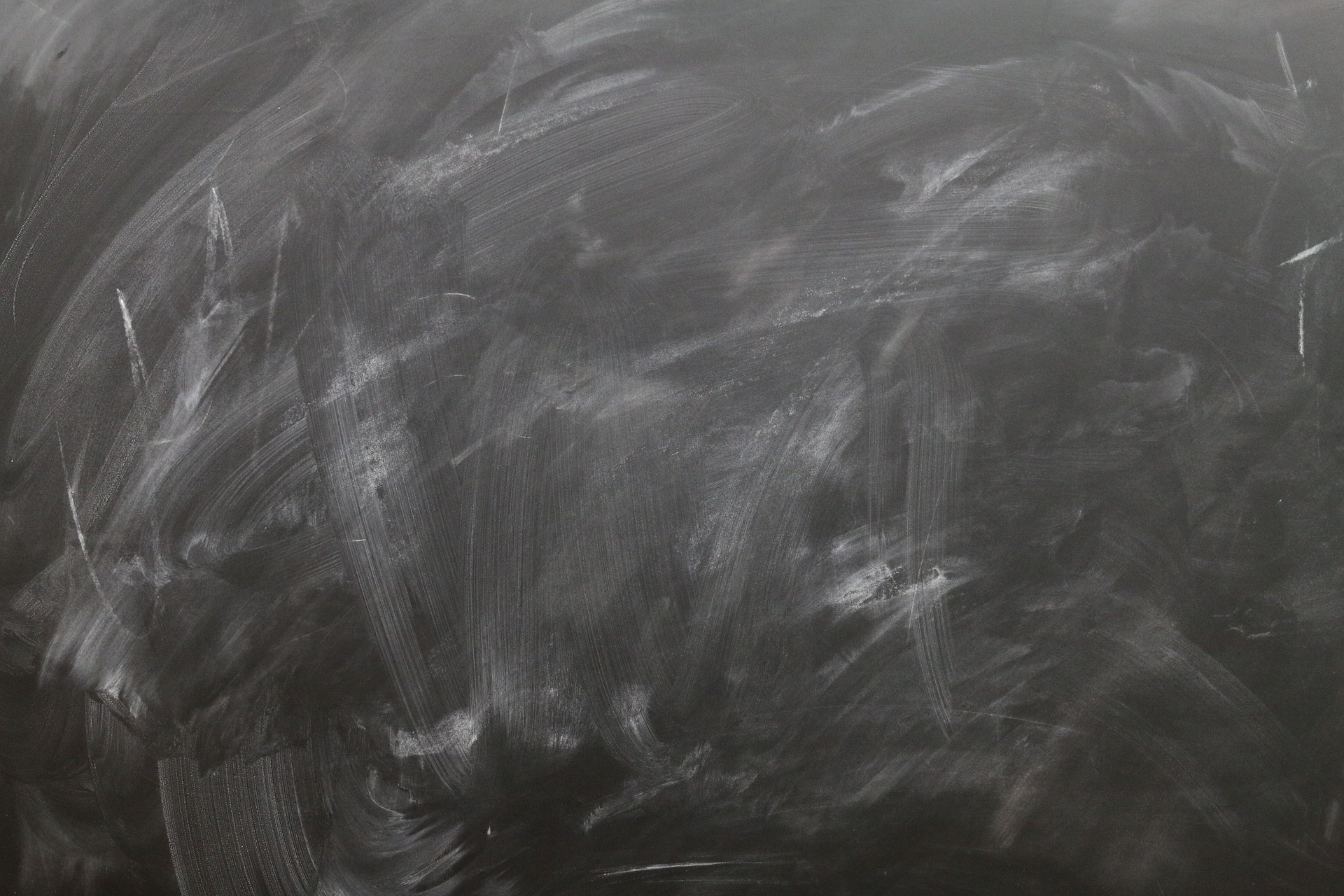11 décembre 2024 | Par Nejma Brahim MEDIAPART
Pour les étrangers, toutes les démarches liées au droit au séjour se font désormais en ligne. Dans un rapport rendu le 11 décembre, le Défenseur des droits épingle les services de l’État et dénonce des « atteintes massives » aux droits des usagers. Mediapart a enquêté sur ces dysfonctionnements.
Il y a tous les discours visant à criminaliser les personnes étrangères en France, présentées au mieux comme des « profiteurs », au pire comme des « délinquants ». Et il y a l’envers du décor : toutes celles et ceux qui mènent une vie tranquille, travaillent, élèvent leurs enfants parfois ; mais bataillent pour obtenir ou renouveler un titre de séjour, plongeant dans l’irrégularité du simple fait des dysfonctionnements de l’État.
Pendant de longs mois, Mediapart a enquêté sur ce que beaucoup qualifient de « maltraitance institutionnelle ». Celle-ci précarise les personnes étrangères, et rend plus difficile le travail des agent·es en préfecture. De façon inédite, des fonctionnaires, mais aussi des avocat·es spécialisé·es en droit des étrangers et étrangères et des juges administratifs, ont accepté de raconter les coulisses de ce cercle vicieux.
Celui de la dématérialisation, mise en place à compter de 2012, d’abord à titre expérimental dans plusieurs préfectures de France avant d’être élargie à d’autres départements (pas tous), parfois sans autre solution pour les intéressé·es. Sur le papier, elle devait faciliter les démarches des usagers étrangers, autrefois souvent contraints de passer la nuit devant leur préfecture dans l’espoir d’obtenir un rendez-vous..
Mais très vite, la solution miracle vantée par les autorités a laissé place à de nombreux blocages, au point que le Conseil d’État vienne retoquer le « tout en ligne » dès 2022, imposant au gouvernement de proposer des alternatives aux usagers. Mercredi 11 décembre 2024, c’est au tour du Défenseur des droits d’épingler l’Administration numérique des étrangers en France (Anef, dans le jargon), dans un avis sévère pointant des « atteintes massives aux droits des usagers ».
Pour Khine*, une Birmane vivant en Seine-et-Marne, le calvaire a justement commencé sur l’Anef, portail numérique dont se sont saisies de nombreuses préfectures ces dernières années, censé permettre aux personnes étrangères de déposer une première demande de titre de séjour, une demande de renouvellement, de changement de statut ou de régularisation. Originaire de Birmanie, la jeune femme s’installe en France en 2019 avec un visa étudiant.
« Quand j’ai voulu renouveler mon titre, j’ai eu un avis favorable et j’ai attendu le SMS m’informant que le titre était prêt à être retiré. Mais je n’ai jamais rien reçu. » Khine appelle la préfecture à maintes reprises et propose de se déplacer. « On me répondait qu’il était impossible de venir sans rendez-vous. » Sur son espace Anef, tout est bloqué. « Je me suis sentie impuissante, j’ai compris que je ne pouvais rien faire. » Son titre expire au bout d’un an.
File d’attente virtuelle
Étudiante dans la mode, Khine bascule dans l’irrégularité et perd des opportunités professionnelles. Lorsque nous la retrouvons au cabinet de son avocate fin octobre, elle explique comment il lui a ensuite été reproché de n’avoir jamais récupéré son titre. « Comment aurait-elle pu faire sans avoir de rendez-vous ?, s’insurge Me Delphine Martin. Elle a dû faire une demande de régularisation alors qu’elle était en règle auparavant. »
Les témoignages comme celui de Khine sont devenus monnaie courante. Sur les réseaux sociaux, les cris d’alarme pullulent : « Je suis détenteur d’un titre de séjour salarié qui expire le 1er janvier 2025. Je cherche un rendez-vous depuis octobre mais il n’y en a pas. J’ai envoyé mon dossier par recommandé, pas de réponse. Je risque de perdre mon boulot », désespère Farid*, un Algérien, sur un groupe dédié. La plupart des personnes bloquées dans leurs démarches saisissent le Défenseur des droits, dans l’espoir d’obtenir de l’aide.
Pour le Défenseur des droits, la dématérialisation ne remplit pas ses objectifs
« Les nombreuses réclamations traitées mettent en évidence que l’Anef […] ne tient pas les promesses qu’elle portait. » C’est ainsi que le Défenseur des droits résume la situation dans son rapport. Des bugs techniques persistants à l’impossibilité de compléter ou de modifier sa demande, la détresse des usagers étrangers est immense, et la marge de manœuvre des agents préfectoraux excessivement réduite. Face aux blocages, les dispositifs d’accompagnement restent très insuffisants. L’institution préconise, entre autres, d’inscrire dans la loi le droit d’effectuer toute démarche de façon non dématérialisée, d’améliorer les sites internet des préfectures ou encore… de renforcer durablement les moyens humains dans les services dédiés.
« Nous sommes très fortement alertés par la situation que vous rencontrez », souligne la défenseuse des droits, Claire Hédon, lors d’un rassemblement organisé par l’association Droits devant !, face aux locaux de son institution, à Paris le 18 novembre. Elle précise alors qu’en 2024, le droit des étrangers et étrangères représente plus d’un tiers des réclamations reçues (celles-ci ont bondi de 400 % en quatre ans). « J’ai vu le premier ministre et je l’ai alerté sur cette situation. On ne vous laisse pas tomber. »
De nombreux étrangers se tournent également vers des avocats spécialisés, qui saisissent à leur tour la justice. Il suffit de s’attarder dans les tribunaux administratifs pour réaliser l’ampleur du phénomène. Au tribunal administratif de Melun, le 22 octobre, les cas – dont celui de Khine – se suivent et se ressemblent : des avocats défilent en robe noire pour expliquer comment leur client·e est sur le point de perdre – ou a déjà perdu – son droit au séjour à la suite de blocages en Préfecture.
« Toutes les histoires sont différentes, rappelle Delphine Martin, mais la préfecture met les gens dans des situations très difficiles. » Aujourd’hui, ajoute l’avocate, « beaucoup de contentieux ne sont dus qu’à ces dysfonctionnements. Les tribunaux sont engorgés de dossiers qui ne devraient jamais arriver jusqu’à eux ». « J’ai passé l’année à faire des référés, complète Elsa Ghanassia, avocate au barreau de Grenoble. Je n’en ai jamais autant plaidé, à raison de quatre dossiers par semaine. »
Le tribunal pour un simple rendez-vous
Pour elle, les tribunaux sont devenus des « chambres d’enregistrement » de la préfecture. « C’est insensé. La majorité du contentieux consiste à obtenir un rendez-vous. On dépose la requête et quelques jours plus tard, la préfecture demande à ne pas statuer, en fournissant une convocation pour un rendez-vous », décrit-elle.
Laurent Charles, avocat à Paris, abonde : « Toutes ces difficultés font exploser le contentieux étranger. Certaines juridictions changent leur jurisprudence, estimant qu’on les saisit trop. »
À Montreuil (Seine-Saint-Denis) ou à Lille (Nord), « c’est de la folie », glisse un magistrat administratif, qui trouve « délirant qu’on ait laissé ce système prospérer », ne laissant pas d’autre option aux étrangers que de saisir la justice. À Lille, poursuit-il, une cellule de magistrats dédiée au contentieux des étrangers aurait vu le jour. Selon nos informations, à Grenoble, les juges administratifs auraient rencontré les services de la préfecture pour évoquer cette problématique.
« Les tribunaux absorbent la charge, on répond à l’urgence. »
Un magistrat administratif
« La justice contribue à débloquer des situations », confirme le magistrat. L’homme se souvient de cette enfant reconnue réfugiée, dont le père s’est vu refuser le droit au séjour. Après avoir déposé un référé, sur l’avis d’audience, le juge découvre qu’un rendez-vous a été proposé au monsieur. « J’ai compris que le tribunal avait eu une influence juste par l’importance qu’il avait accordée à l’affaire. »
Le juge évoque une « masse énorme » d’affaires à traiter, qui empêche de réfléchir à la manière dont cette quantité pourrait être réduite. « Les tribunaux absorbent la charge, on répond à l’urgence. » Certain·es magistrat·es, estime Elsa Ghanassia, ont tendance à fermer les portes ; d’autres à en ouvrir. « Mais on sent qu’ils sont tous un peu déconcertés et débordés par la situation. »
Pour le magistrat déjà cité, les juges administratifs gagneraient à aller au bout de leurs pouvoirs, « quitte à passer pour ceux qui sanctionnent, pour éviter de nourrir un cercle vicieux ». Et puisqu’il arrive que la préfecture ne propose pas de rendez-vous malgré une décision du tribunal l’y enjoignant, il suggère de penser plus souvent aux astreintes financières pour « contraindre l’administration ».
« Si on ne le fait pas, la préfecture continuera et l’étranger engagera de nouvelles procédures au tribunal, ce qui n’arrange personne. » Selon les différents rapports publics des juridictions administratives, le droit des étrangers et étrangères représentait 30 % des affaires enregistrées auprès des tribunaux administratifs en 2015, puis 35 % en 2018. En 2022 et en 2023, après la mise en place de la dématérialisation, ce chiffre atteint 43 %.
En plus de leurs plaidoiries, certains avocats, à l’instar de Laurent Charles, tentent d’obtenir des victoires au sein même des préfectures. En onze ans d’activité, l’avocat a pu constater l’évolution de la situation. « Jusqu’en 2021, il y avait une bonne entente entre avocats et agents. » Citant les préfectures d’Île-de-France une à une, il raconte comment, petit à petit, des agents n’ont plus été autorisés à le saluer ou à le renseigner sur ses dossiers.
Des agents en sous-effectif
Ses équipes peuvent envoyer jusqu’à cinquante mails par jour. Il dit parvenir encore à obtenir des résultats dans plusieurs préfectures, sans avoir à passer par la case « tribunal ». Mais ailleurs, des portes ont pu se refermer. En Essonne, il se remémore une agente particulièrement dure à l’endroit des étrangers, et sa tasse préférée : « Je suis une connasse et je l’assume. »
À ses yeux, il y a une « volonté explicite » de ne pas délivrer « trop de titres » : celle-ci se traduit elle-même par l’ampleur de la dématérialisation, le manque de formation des agent·es et de coordination entre services, le manque de moyens humains ou les sensibilités politiques de certains responsables… « Tout cela contribue à la fabrique de sans-papiers. »
« On joue avec la vie des gens, sauf qu’on ne nous prépare pas à ça quand on arrive. »
Yasmine*, agente en préfecture
Agente dans une préfecture d’Île-de-France durant deux ans après le Covid-19, Yasmine* affirme avoir fait « remonter pas mal de choses » à sa hiérarchie, tout en sachant que cela ne changerait rien. « Il y a du budget, mais pas pour les agents, et encore moins pour les étrangers. On le garde pour le champagne du préfet », tacle-t-elle. En attendant, « on presse les agents comme des citrons », jusqu’à ce qu’ils partent.
Passée par un autre ministère, elle constate et déplore un manque de formation, et dit avoir formé des recrues sur des sujets qu’elle ne maîtrisait pas. « Il m’est arrivé de refuser le droit au travail d’une personne qui pouvait en fait y prétendre. Et avec la dématérialisation, elle ne pouvait plus rien faire ensuite. » À plusieurs reprises, Yasmine a culpabilisé, se demandant si elle n’avait pas contribué « à des licenciements ou des mises à la rue ».
« On joue avec la vie des gens, sauf qu’on ne nous prépare pas à ça quand on arrive. Quand je l’ai réalisé, je me suis vite formée. » D’autres font en sorte de garder « une distance » avec la vie des usagers, confortés par la dématérialisation et l’absence de contact avec les concernés. « Chacun ses problèmes », lâche un agent qui recevait du public avant la mise en place de l’Anef dans sa préfecture – parmi celles qui fonctionnent le mieux en France.
Choix politique
Lorsqu’il se confie à Mediapart, son service a reçu mille mails en six jours. « Les gens aiment bien nous harceler, dit-il, tout en reconnaissant que ces personnes sont en fait désespérées. Certains nous écrivent alors qu’ils dépendent d’une autre préfecture. » Avec du recul, Yasmine voit en ces chiffres une « pression ». « Un rouleau compresseur. » À raison de quatre-vingt-cinq rendez-vous par jour pour quatre agents dans son service (ils étaient une dizaine à son arrivée), la charge de travail est « énorme ». « Plus on avance, plus on nous en rajoute. »
Comme lorsque ses collègues du service contentieux de la préfecture viennent la voir, « au moins une fois par semaine », pour qu’un rendez-vous soit donné « le plus rapidement possible » à un étranger à qui le tribunal a donné raison. En face d’elle, beaucoup de « désespoir » et d’incompréhension. Elle se met à la place d’un usager étranger naviguant sur le site de la préfecture : « On ne comprend rien si on vient d’un pays étranger. »
À lire aussi
Quant à l’Anef, « c’est la merde », résume-t-elle. « S’il y a le moindre bug, les gens restent bloqués. Ils ne peuvent pas rentrer en préfecture sans rendez-vous. Et s’ils arrivent à en prendre un, on l’annule dès qu’on voit qu’ils dépendent de l’Anef. » L’adresse mail de contact de la préfecture ? « Personne ne traite les mails, parce qu’il n’y a pas assez d’agents. »
Les plateformes ont des avantages, commente l’avocate Delphine Martin, mais cela déshumanise. « Il est plus facile de dire non dans un message. Et il y a tellement de situations où l’on ne rentre pas forcément dans les cases, où il faut donner un contexte… »
Comment en est-on arrivé là ? Yasmine, comme beaucoup d’autres acteurs, y voit un « choix politique ». « Si l’État le voulait, il pourrait mettre plus de moyens pour embaucher. » Une centaine de personnes à l’échelle de la France ainsi que la réouverture de certaines sous-préfectures permettraient d’améliorer la situation, selon elle.
En attendant, « il y a une violation totale et systématique de la loi depuis la mise en place de la dématérialisation », dénonce l’avocate Elsa Ghanassia. Pour son confrère Laurent Charles, c’est le principe même d’égalité devant les services publics qui n’est plus garanti. Et Delphine Martin de s’interroger sur ce système contreproductif : « L’État paie des frais quand on gagne en justice… Est-ce qu’il ne devrait pas mettre cet argent ailleurs, pour augmenter les moyens en préfecture ?